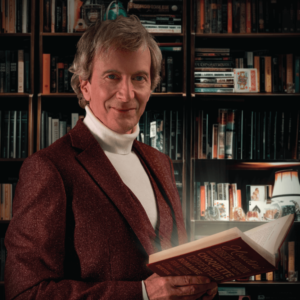Développer les compétences des futurs médecins par l’observation d’œuvres d’art: un projet mené par l’Université de Montréal en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal et Culture Trois-Rivières, permet aux étudiantes et étudiants en médecine d’enrichir leur formation pour offrir de meilleurs soins à la population.
La Faculté de médecine de l’Université de Montréal s’allie au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et à Culture Trois-Rivières dans un projet novateur: enrichir la formation des futurs médecins par l’intermédiaire d’œuvres d’art. En complément à des activités en classe, des visites-ateliers au musée leur permettent de parfaire leurs compétences en communication et d’affiner leur sens de l’observation clinique.
Composée de trois visites-ateliers au MBAM, cette formation inédite est offerte à près de 350 étudiants et étudiantes de première année en médecine du campus de Montréal. Un projet parallèle a également été mis en place, bénéficiant de l’expertise du MBAM, auprès de 50 autres étudiantes et étudiants du campus de l’UdeM en Mauricie, en collaboration avec le Centre d’exposition Raymond-Lasnier de Trois-Rivières.
« Les objectifs de ce projet sont multiples. Nous voulons que nos étudiants et étudiantes affinent leur sens de l’observation, découvrent leurs biais personnels et s’ouvrent à la diversité des perspectives. Ces compétences – la recherche de preuves, l’introspection, la tolérance à l’incertitude – sont directement transposables à la pratique médicale et font partie de la prise en charge des patients. Ainsi, l’art sert de catalyseur et le musée devient un lieu propice au développement de ces habiletés », soutient Aspasia Karalis, professeure adjointe de clinique à la Faculté de médecine de l’UdeM et instigatrice du projet.
« Le Musée offre un formidable cadre d’apprentissage, complémentaire aux salles de classe et aux milieux de soins. Nos ateliers, conçus autour des oeuvres de notre riche collection, permettent aux étudiantes et aux étudiants de développer des compétences d’observation et de communication essentielles à une pratique médicale sensible et empathique. Ce projet renforce les liens de longue date du MBAM avec les acteurs de l’éducation et de la santé et nous permet de partager notre expertise avec les médecins apprenants: être à l’écoute, porter attention aux détails, raconter les oeuvres à partir de ses observations en faisant appel à ses expériences. Toutes ces aptitudes développées au musée par les futurs médecins bénéficieront à leurs futurs patients », affirme Mélanie Deveault, directrice de l’éducation et de l’engagement communautaire, titulaire de la Chaire Ariane Riou et Réal Plourde pour l’art et l’éducation au service de la communauté, au MBAM.
« Depuis plus de 50 ans, le Centre d’exposition Raymond-Lasnier façonne la vie culturelle trifluvienne avec audace et engagement. Ce partenariat communautaire nous désigne comme un acteur significatif dans notre milieu. Il nous permet de faire oeuvre utile dans notre communauté. L’équipe des arts visuels de Culture Trois-Rivières est fière de contribuer à la formation de la relève médicale avec cette innovation pédagogique démontrant l’importance de l’humanité et de l’art », ajoute Marie-Andrée Levasseur, directrice des arts visuels, Culture Trois-Rivières
Que peut apprendre un futur médecin en observant une oeuvre d’art?
Ces ateliers mettent en pratique des stratégies de pensée visuelle (visual thinking strategies), fruit d’une collaboration scientifique entre la psychologue américaine Abigail Housen et le muséologue Philip Yenawine, ancien directeur de l’éducation au Museum of Modern Art (MoMA) de New York. Cette approche, qui privilégie les échanges en petits groupes, utilise l’observation d’oeuvres d’art pour développer la pensée critique, les compétences en communication et la collaboration. Elle encourage les discussions ouvertes et amène les participants à développer leurs capacités d’analyse et d’interprétation du contenu visuel. Elle repose sur trois questions clés: que se passe-t-il dans cette oeuvre? Que voyez-vous qui vous fait dire cela? Que pouvons-nous trouver de plus? Une facilitation experte de ces échanges par le médiateur culturel, puis la mise en lumière de l’applicabilité du processus en médecine par le médecin complètent l’exercice.